

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Histoire du football au Brésil – Michel Raspaud (ed. Chandeigne – 2010) Tout amoureux du football attend beaucoup d’un livre intitulé Histoire du football au Brésil, tant ces deux mots associés ont formé un mythe: par la virtuosité de ses joueurs, symbolisée par Pelé ; par sa réputation d’un jeu offensif, technique; par son palmarès : la Seleção, seule équipe à avoir disputé les 19 éditions, a été 5 fois victorieuse en Coupe du monde… Quand on aborde cet ouvrage de Michel Raspaud, sociologue du sport, on a envie de comprendre les conditions qui ont permis un tel rayonnement mondial, de connaître les raisons d’une telle empreinte dans la société et la culture brésiliennes. Et l’auteur cherche à y répondre en nous donnant beaucoup d’informations sur le passé et la réalité présente (avec tableaux, graphiques et cartes), puisant dans l’abondante production du pays lui-même sur le sujet (journaux, écrits d’universitaires ou d’écrivains). |
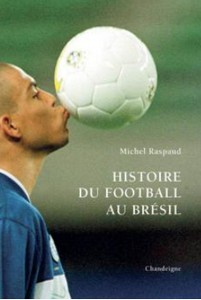 |
| L’implantation du football au Brésil Notre curiosité est comblée quand il présente l’introduction et la diffusion de ce sport dans le pays (chap. 1 et 2). La conquête du pays par ce sport suit des étapes classiques. Il est importé à la fin du XIXe dans les villes du Sud Est et du Sud (São Paulo et Santos, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte), en plein essor économique et démographique, par les immigrations, anglaise évidemment (Charles Miller en 1894 à São Paulo), mais aussi italienne, allemande, portugaise, espagnole, japonaise… M. Raspaud raconte avec précision la naissance, dans les premières décennies du XXe, de clubs qui aujourd’hui encore tiennent le haut du pavé : à Sao Paulo, Corinthians et Palmeiras, ainsi que dans le port de Santos (Santos FC); à Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo, Flamengo, Vasco de Gama. D’abord l’apanage des classes aisées, il s’enracine dans les classes populaires, plus rapidement à São Paulo qu’à Rio. Des ligues d’Etat s’organisent, qui dans cet immense pays fédéral créent leurs championnats propres, attirant de vastes publics et suscitant la création de grands stades. Ce qui pose mécaniquement la question du professionnalisme chez les dirigeants tenants de l’amateurisme coubertinien: d’un simple dédommagement du manque à gagner chez les pratiquants (entraînements, déplacements), on passe à une rémunération plus ou moins clandestine, provoquant des conflits, jusqu’à l’officialisation du professionnalisme en 1933. Cette question sociale rencontre une autre « question sensible » dans ce pays « multicolore », où l’esclavage n’a été abrogé qu’en 1888: celle sous-jacente des « races », qui ne prend toutefois pas les formes aiguës de l’Afrique du Sud ou des Etats-Unis (1). Ici aussi, après d’âpres discussions et scissions, le talent l’emportera sur les distinctions de couleurs, comme en témoigne la belle carrière du métis Arthur Friedenreich dans les années 20-30. L’organisation du football au Brésil Le lecteur perçoit bien également l’organisation du football de haut niveau au Brésil (Chap.6). C’est dans 4 Etats du Sud Est et du Sud, les plus développés économiquement du pays, en particulier São Paulo, que se concentrent les meilleurs clubs, dotés des plus gros budgets car ils bénéficient de l’apport des sponsors (multinationales ou entreprises nationales), des équipementiers, des droits télévisés et réalisent le meilleur « merchandising ». Ce sont eux aussi qui connaissent les plus fortes affluences, dans les championnats d’Etat plus que dans le championnat national (le Brasileirão, créé en 1971) à quelques exceptions près, grâce aux derbys entre équipes rivales : par exemple « Fla-Flu » à Rio, Corinthians-Palmeiras à São Paulo, Gremio-Internacional à Porto Alegre etc. Même si les records de spectateurs obtenus entre 1962 et 1977 ne peuvent plus être atteints, en raison des nouvelles règles de sécurité qui ont réduit la capacité des stades. Les clubs de ces Etats ont remporté 91% des titres nationaux (Championnat, Coupe) de 1959 à 1979, ne laissant que des miettes aux autres; le championnat national, depuis sa nouvelle formule (en 2003, semblable aux championnats européens, d’avril à décembre), n’a été remporté que par des équipes de São Paulo. Mais, en Copa Libertadores (créée en 1960, équivalent sud-américain de la Ligue des champions européenne), ils ont été souvent supplantés par des clubs argentins ou uruguayens, concentrant encore davantage l’élite (Boca Juniors et Estudiantes à Buenos-Aires, Penarol et Independiente à Montevideo). L’auteur nous donne aussi un aperçu de la gestion approximative, opaque et constamment déficitaire des clubs ; du statut longtemps « esclavagiste » des joueurs, soumis au système du « passe », c’est-à-dire à la bonne volonté des dirigeants pour leurs transferts, avant la « loi Pelé » de 1998, qui a tenté de mettre fin à ces pratiques, tant pour la gestion des clubs que pour le contrat des joueurs ; enfin des « cadences infernales » auxquelles sont soumis les joueurs, du fait de l’accumulation des compétitions (Championnat d’Etat, Coupe du Brésil ou Copa Libertadores, Championnat national, et rencontres internationales pour les sélectionnés) . L’exode massif des joueurs brésiliens Autre point très intéressant de cet ouvrage, c’est la mise en exergue de l’émigration massive des joueurs brésiliens à l’étranger depuis les années 1980 (chap.7). Elle résulte de la pauvreté relative et de l’endettement des clubs brésiliens (2), tous les postes de recettes habituels indiqués plus haut étant bien inférieurs à ceux des clubs européens. Les recettes au guichet d’autre part ne représentent que 7% de celles-ci: les tableaux présentés établissent que les moyennes annuelles de spectateurs en Série A sont inférieures et plus variables qu’en France: à côté des « affiches » ont lieu des matches devant des stades quasi déserts ; d’autre part, le prix des billets est faible en raison du niveau de vie de la population. L’arrêt Bosman (1995), supprimant la rivalité dans les transferts avec « les joueurs communautaires » de l’Union Européenne, a créé un « appel d’air » pour les joueurs extracommunautaires : la principale plus-value des clubs en perpétuel déficit, assurant 30% des recettes, est alors la vente des joueurs, activée par les agents de joueurs officiels ou officieux (pas toujours scrupuleux) et récemment (2005) par la « société de location » « Deportivo Brasil », membre du groupe de marketing sportif « Trafic » (sic !). L’auteur présente ainsi un tableau éclairant (p.120): le nombre des sélectionnés dans l’équipe du Brésil jouant à l’étranger ne cesse d’augmenter depuis 1982, pour représenter aujourd’hui la presque totalité de l’effectif. 80% des joueurs professionnels ne gagnent pas plus de 2 fois le salaire minimum du pays, et même les « vedettes » brésiliennes de retour au pays (Ronaldo, Adriano…) sont loin d’y retrouver les salaires qu’elles touchaient en Europe. On comprend que cet exode ne se fait pas seulement vers les grands clubs européens, mais entraîne des Brésiliens vers des destinations sur tous les continents, certaines inattendues! La place du football au Brésil Dans un chapitre entier (chap.3), il raconte la « tragédie nationale » qu’a représentée la finale perdue par l’équipe du Brésil contre l’Uruguay (1-2) en Coupe de monde 1950, dans « son » stade de Maracana, spécialement construit après maintes tribulations pour l’occasion. La victoire devait représenter l’accession du Brésil au rang des « grands pays », la défaite sera ressentie comme l’impuissance du peuple brésilien à assumer son destin, relançant des débats sur les « races » : mais n’était-ce pas trop demander à 11 joueurs d’un match de football, qui n’est qu’un jeu entre 2 équipes ? Sachant que l’Uruguay avait aussi de grands joueurs (Schiaffino, Ghiggia)… A ce propos, dans sa conclusion, il rappelle que l’accueil de la Coupe du monde 2014, de même que l’organisation des JO en 2016, jouera le même rôle politique d’affirmation du pays comme grande puissance émergente… avec le traumatisme de la défaite sportive de 1950 à effacer! Le chapitre final (chap.8) revient sur les rapports du « futebol » et de la société brésilienne (dans son introduction déjà, il estimait que celui-ci « est plus qu’un sport. C’est un art, une philosophie, une manière d’appréhender l’existence »). Pour lui, cette inscription tient à la légitimité culturelle précoce que lui ont apportée les intellectuels du pays (grands journalistes, écrivains, poètes et universitaires), favorisant son ancrage comme patrimoine national pour l’ensemble du peuple brésilien. Il montre aussi l’importance des « torcidas », les groupes de supporters organisés attachés aux équipes, pour le meilleur (le bonheur collectif de vivre ensemble, lié à la « cordialité » des Brésiliens) comme pour le pire (un « supporterisme » agressif parfois); il ne fait qu’évoquer la « fonction sociale » des clubs pour les « socios », sans hélas préciser. Il insiste enfin sur le maillage serré des écoles de football (« escolinhas ») dans tout le pays, depuis celles centrées sur la détection des talents jusqu’à celles visant à trouver un emploi ou à but social et éducatif. Un sentiment de frustration Le lecteur en apprendra donc beaucoup sur le football brésilien. D’où vient alors que nous restions sur notre faim à la fin de l’ouvrage, concernant un aspect dont nous voulions saisir les racines, le jeu brésilien qui a enchanté le monde en 1958, 1970, 1986? Ce n’est pas le décevant chapitre 4 qui y répond : quand l’auteur évoque la « Seleção » dans les Coupes du monde, il se cantonne à de rapides résumés de son parcours, avec les scores des matches et la mention de grands joueurs (le buteur Leonidas en 1938, les débuts marquants du jeune Pelé en 1958, Garrincha en 1962, Romario en 1994 et Ronaldo en 2006). Le lecteur ne « voit » pas le jeu pratiqué, à l’exception de quelques lignes abstraites pour la Coupe du monde 1970 : « un jeu constamment tourné vers l’offensive et la recherche de solutions […]. Probablement la meilleure équipe que l’on ait jamais vue dans toutes les Coupes du monde ». Des récits plus vivants, des illustrations plus concrètes d’actions s’imposaient… De même, c’est seulement de-ci de-là qu’il permet de s’en faire une idée. L’auteur donne la parole au grand sociologue Gilberto Freyre pour indiquer ses caractéristiques : « Notre style paraît contraster avec ceux des Européens par une conjonction de qualités, de surprise, de ruse, d’astuce, de légèreté et en même temps de spontanéité individuelle. Nos passe, nos dribbles, nos tromperies, nos fioritures avec le ballon ont quelque chose de la danse ou de la capoeira qui arrondissent et adoucissent le jeu inventé par les Anglais ». Il cite aussi d’autres auteurs qui le rapprochent du sens du « brincar » chez les Brésiliens, terme qui signifie à la fois « jouer » et « plaisanter ». Il signale le formidable réservoir de joueurs possédé par le pays, ce qui explique son dynamisme constamment renouvelé dans l’éclosion de talents: tous les garçons ont tapé jeunes dans la balle, dans des parties de football sauvage, fondées sur le plaisir de jouer. On aurait aimé à cet égard qu’à côté de la pratique de l’élite, l’auteur nous en dise plus sur celle des échelons plus modestes, au niveau amateur. On peut d’ailleurs se demander si cette manière de jouer va se perpétuer, avec le départ des joueurs vers les championnats étrangers, qui risquent de gommer leurs qualités propres. L’auteur parle de cet objectif de migration future comme « l’élément désormais structurant de la politique de détection, de formation et de recrutement des clubs brésiliens sur leur propre territoire ». Autre objet d’inquiétude: la disparition progressive des « terrains vagues », école spontanée de ce jeu, dans les métropoles en proie à une urbanisation anarchique. L’âge d’or du football brésilien est-il derrière nous, à cause d’une mondialisation qui homogénéise les styles, et pas dans le bon sens? Comme l’auteur se le proposait en introduction, cette synthèse comble vraiment un vide, ce qu’apprécieront tous les amateurs de football. Peut-être étions-nous trop exigeant quand nous demandions à un ouvrage de sociologie de nous donner les clefs d’approche du fameux « jeu à la brésilienne »… Mais il reste la possibilité de compléter cette lecture par celle du recueil de nouvelles Onze au Maracanã de l’écrivain brésilien Edilberto Coutinho (ed. Le Serpent à plumes 1994)! (1) Confrontant deux « autobiographies » de Pelé (rédigées avec des collaborateurs) à 30 ans de distance, l’auteur dans le chapitre 5 lui reproche de nier dans la première (1977) les préjugés raciaux au Brésil, de façon injuste à notre avis, car il constate que le footballeur ne fait que reproduire l’opinion courante à l’époque ; l’homme a évolué sur cette question dans la deuxième version de 2006 parce qu’il en a pris conscience plus tard comme toute la société brésilienne, d’autant plus qu’alors, comme personnalité mondialement reconnue, il n’a plus à en souffrir personnellement. Sans faire preuve d’idolâtrie, nous trouvons également discutable la comparaison, comme « types d’hommes », entre Garrincha et Pelé, favorable au premier. (2) Il faut savoir aussi qu’à côté des sources de financement habituelles s’est mise en place depuis les années 90 la « parceria » : des fonds d’investissement américains et anglais investissent dans les plus grands clubs à long terme (10 à 15 ans généralement), et récupèrent une partie des recettes, qui va de 33% (pour Vitoria) jusqu’à 75% (Flamengo), notamment sur les transferts de joueurs (via des sociétés écrans établies dans des paradis fiscaux) cf Economie politique du sport professionnel (p. 84-85) J-François Bourg et J-Jacques Gouguet (ed. Vuibert 2007) (3) Reléguant le championnat brésilien à un niveau de 2ème zone. C’est aussi vrai pour l’Argentine ou l’Uruguay. Si bien que les clubs de ces 3 nations se font battre maintenant en Copa Libertadores par des équipes d’autres pays latino-américains. Loïc Bervas (février 2011) |